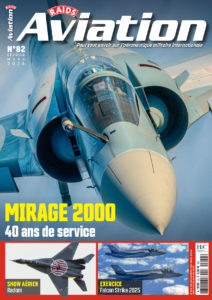RAIDS AVIATION N°79 – AOUT-SEPTEMBRE 2025
La Tsar Bomba, officiellement désignée « AN602 » ou « Ivan », est la bombe nucléaire la plus puissante jamais testée. Développée par l’Union soviétique, cette arme d’une puissance exceptionnelle a marqué l’histoire de la prolifération nucléaire et de la dissuasion stratégique.
Démontrer la supériorité soviétique
Ce sont les Occidentaux qui en ont fait la meilleure publicité en la nommant « Tsar Bomba ». « Les capitalistes nous vendront eux-mêmes la corde avec laquelle nous les pendrons », disait Lénine… L’appellation « Tsar Bomba » ne venait donc pas de l’imagination des Soviétiques. Pour eux, la RDS-202 ou RN-202 était la bombe « Ivan », ou encore la « Kuzkina mat » faisant référence à Nikita Khrouchtchev, l’homme d’État soviétique qui présidait alors l’URSS (1). Khrouchtchev avait voulu « Ivan » comme « outil de spectacle » pour prouver aux Occidentaux qu’ils ne pourraient plus faire plier l’URSS, comme à Berlin en 1949 (2).

Conçue dans le cadre du programme soviétique de missiles stratégiques, la Tsar Bomba a été pensée pour surpasser en puissance les armes nucléaires américaines, notamment la bombe H. Le contexte géopolitique des années 1950-1960, marqué par la course aux armements, a donc conduit à la conception de cette bombe pour démontrer la supériorité soviétique.
Développement
La RDS-202 a été développée par le bureau d’études de Yulii B. Khariton et Andreï D. Sakharov. Cette bombe à hydrogène pesait 36 298 kg, un poids démentiel pour un engin devant être emporté par un bombardier qui, en conséquence, n’aurait plus assez d’autonomie pour mener une mission intercontinentale. Finalement, une version allégée ne pesant plus que 18 149 kg (!) fut étudiée, ce qui posait encore la question du vecteur qui l’emporterait. Ainsi, le 17 mars 1956, le bureau d’études OKB de l’entreprise russe de défense et de conception aérospatiales Tupolev reçut l’ordre d’étudier un bombardier qui pourrait réaliser la mission « spectacle ». Deux options furent envisagées : le biréacteur Tu-16 et le Tu-95. Il sembla vite évident que ce dernier, avec ses quatre moteurs NK-12M de 14 790 ch unitaires, était le plus apte. Mais fallait-il encore l’adapter au format délirant de la RDS-202, car les dimensions de sa soute n’étaient pas ad hoc. Un projet de modification de ce porteur, sous désignation Tu-95V, fut donc confié à A. V. Nadaschkevitch, alors directeur des armements chez Tupolev. C’est le Tu-95 de série 5800302 (ou simplement 302), assemblé en 1955, qui fut choisi pour subir cette transformation.
La soute à bombes du Tu-95 fut rallongée jusqu’à 7,15 m, et sa largeur à 1,75 m. Cela étant, l’espace occupé par cette nouvelle soute limitait alors le volume des réservoirs du fuselage, ce qui réduisait l’emport en carburant et, par conséquent, l’autonomie de l’avion. Mais cela importait peu à ce stade, puisqu’il ne s’agirait que d’une démonstration. Il fut installé un mécanisme de port et de largage adapté à la taille d’Ivan, en reprenant le râtelier à poutre BD-206 dédié au missile Kh-20 emporté sur Tu-95K. Ce dispositif final, nommé « BD7-95-242 », comportait trois racks de bombes capables de supporter chacun 8 167 kg de charge. La séparation de la charge de tous ces points d’attache simultanément a dû être synchronisée au terme des essais en vol en septembre 1959 à Zhukovskii.

Les préparatifs
Le largage devait avoir lieu au-dessus d’une zone d’essais nucléaires, en amont de l’île de Nouvelle-Zemble, le 30 octobre 1961. Le vol de largage serait conduit depuis la base aérienne d’Olenya, en péninsule de Kola, où le Tu-95V Bear (302) fut affecté. La bombe Ivan était, de son côté, livrée par voie de chemin de fer, et assemblée avec son détonateur et ses transmetteurs sur place, dans un local aménagé. Mais, surprise, son poids était monté à 24 tonnes avec, en plus, 800 kg de parachute retardateur. Elle était donc plus lourde que prévu à l’origine, cependant, le Tu-95V pourrait encore décoller.

En outre, sa taille rallongée à 8 mètres, sur 2,1 pouces de diamètre, était trop imposante pour qu’elle soit incrustée dans l’avion, comme prévu. Finalement, les portes de la soute ont été démontées ; la bombe serait partiellement enfoncée dans le fuselage. Le Bear était peint en blanc antiradiation et doté d’instruments pour mesurer la chaleur dégagée et le niveau des ondes de choc. Pendant l’essai, le Tu-95V devait être accompagné par le Tu-16A (3709), un laboratoire volant peint lui aussi en blanc et équipé sur place, à Olenya, d’appareils radio-télémétriques, d’oscilloscopes, de calorimètres et, surtout, de caméras pour filmer le déroulement de l’essai. Les opérations du Tu-95V seraient coordonnées quant à elles par radio au départ de la station D6, située à 260 km au sud du point d’impact. Le personnel de la station D8, à 90 km au sud de l’impact prévu, opérait les matériels de mesures enterrés à 2 km du point zéro.
L'essai
Le Tu-95V et le Tu-16 ont décollé d’Olenya vers 9 h 30, heure de Moscou, le 30 octobre 1961 en direction de l’île de Nouvelle-Zemble. À 11 h 33, le Tu-95 survolait la zone d’essais à 10 500 m ; le Tu-16 se tenant à 14 km de distance de lui pour filmer le déroulé de l’essai. Le Bear largua sa charge de 58 mégatonnes. Après 188 secondes de chute libre, Ivan ralentit grâce à son parachute de freinage et explosa à 4 200 mètres du sol, à la position 730 51′ N 540 30′ E. Une explosion apocalyptique s’en est suivie, avec une boule de feu, puis un champignon de 64 km d’altitude et de 40 km de diamètre. Le Tu-95V se trouvait déjà à 39 km du point de détonation, puis à 115 km lorsque l’onde de choc l’a rattrapé. Le Tu-16 se situait quant à lui à 53,5 km de la détonation, et à 205 km quand il fut rattrapé par l’onde. Sous la violence de cette dernière, les deux avions ont perdu 900 mètres d’altitude, avant que leurs équipages n’en reprennent le contrôle. Leurs revêtements blancs ont été consumés et, malgré une panne de communication de nature radiologique, ils ont réussi à retourner à Olenya. L’onde de choc fut ressentie dans le monde entier. Ivan aura provoqué son effet dissuasif. Elle a décapité tout le relief autour de son point d’impact et, à cause de son poids qui pénalisait son emport, elle n’apportait aucune valeur ajoutée à la dissuasion soviétique ; elle ne sera donc jamais produite en série.
La Tsar Bomba, par sa puissance exceptionnelle, incarne le sommet de la technologie nucléaire soviétique. Son test a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire militaire et politique mondiale, illustrant à la fois le génie technique et les risques extrêmes liés à la prolifération nucléaire.
Puissance : 50 Mt de TNT, à savoir une explosion environ 3 800 fois plus puissante que la bombe atomique d’Hiroshima.
Poids : environ 27 t, ce qui la rend difficile à déployer sur des vecteurs classiques.
Dimensions : longueur d’environ 8 m ; diamètre de 2,1 m.
Type d’arme : bombe thermonucléaire à fission-fusion, utilisant un principe de fusion nucléaire pour générer une quantité considérable d’énergie.
La Tsar Bomba utilisait un système de déclenchement à deux étages :
— un explosif à fission initial déclenchant la fusion ;
— la fusion nucléaire, libérant une quantité colossale d’énergie.
Elle comportait une enveloppe de plomb pour réduire l’effet de souffle, car la puissance initiale aurait été catastrophique sans cette réduction.